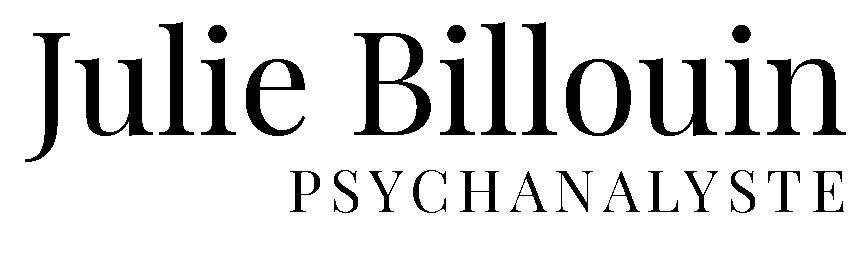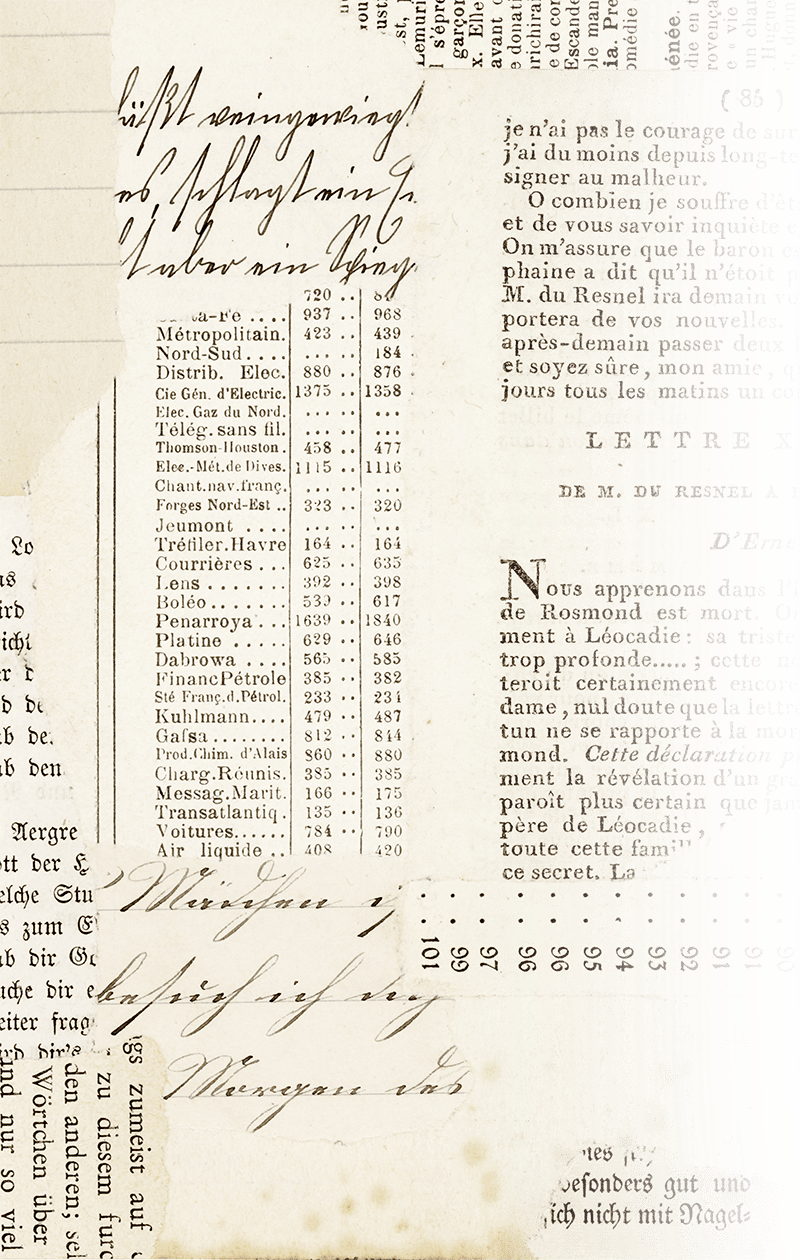
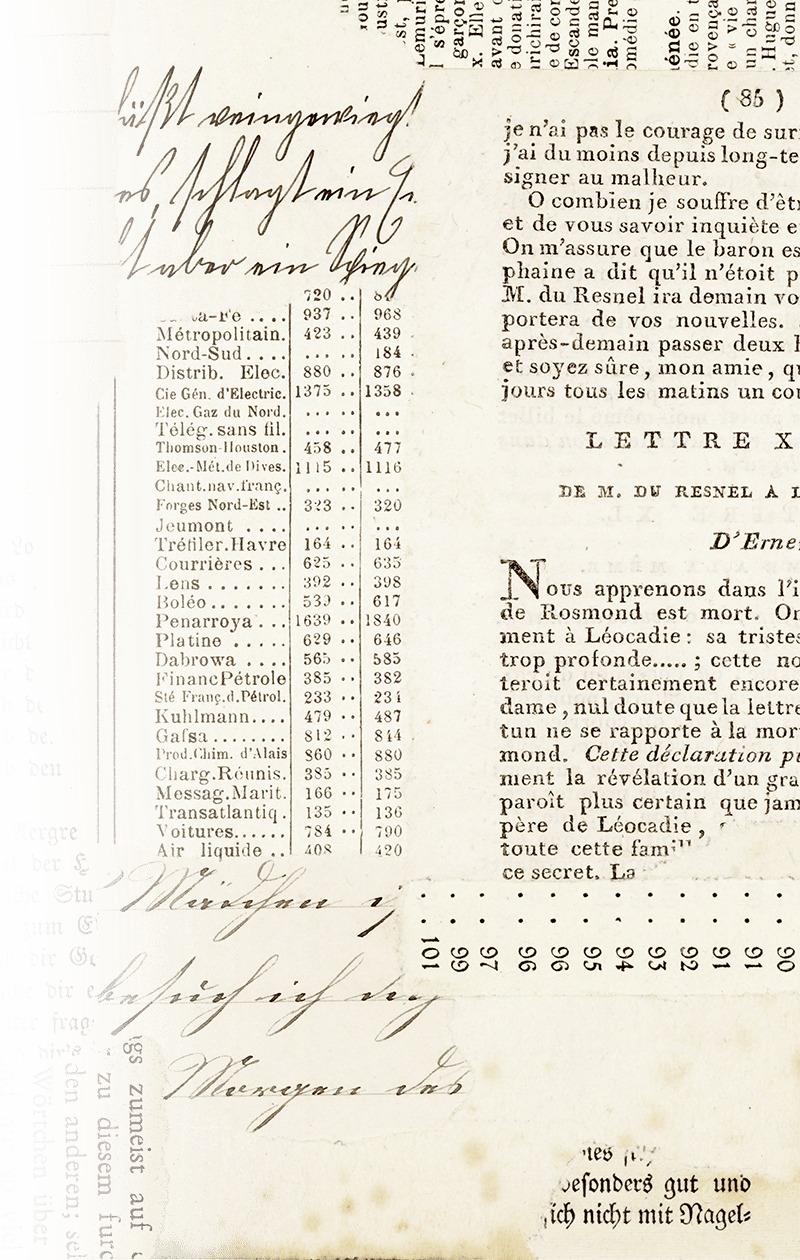
- Accueil
- Ecrits & Publications
- Intervention au XXIXe colloque du RPH - Julie Mortimore - 21 novembre 2015
Intervention au XXIXe colloque du RPH - Julie Mortimore - 21 novembre 2015
Le symptôme comme chiffrage de la jouissance
Le symptôme comme chiffrage de la jouissance, voilà les deux termes qui font le quotidien de la cure : le symptôme et la jouissance, à savoir ça souffre et ça jouit ! Quand souffrance et jouissance s’invoquent, s’enlacent et s’entrechoquent, elles se cristallisent dans le symptôme, sous une forme chiffrée, cryptée.
Que ce symptôme s’exprime dans l’organisme, le corps, ou le psychisme, celui qui souffre le vit d’abord comme quelque chose d’étranger à lui. Il débarque à nos consultations généralement avec la demande de se débarrasser de ce symptôme qui fait souffrir, qui empêche, encombre, gâche sa vie, mais pas seulement, et c’est là tout l’art du clinicien de l’y emmener. Bien qu’il fasse énigme pour le sujet, dans le sens où ce symptôme veut dire quelque chose qu’il ne sait pas encore, il chiffre une vérité bien plus intime, mais pour le moment insupportable, et tout le travail du clinicien consiste à tirer le bateau de la cure vers ce non-savoir qui fait souffrir.
A partir du moment où le sujet se rend compte que son symptôme est à décoder, à déchiffrer, la porte s’ouvre vers la possibilité d’une découverte, d’un inconnu, d’un voyage avec soi-même qui nécessitera du courage, du désir, des efforts, et le désir du clinicien dans l’affaire. Je dis bien des efforts parce que cela revient régulièrement dans le discours de ceux que je reçois au quotidien : « ça demande trop d’efforts de venir, c’est trop dur, c’est trop de contraintes !». Et oui, et heureusement d’ailleurs, le chemin de la cure demande un investissement, un engagement, un désir décidé pour trouver un apaisement véritable et lâcher sa souffrance qui n’est pas si étrangère que cela, c’est ce que nous allons voir. Pour y accéder, il y a un prix à payer dans sa cure ! C’est inévitable.
Cet apaisement, quel est-il ?
Nos voisins TCCistes et autres hypnotiseurs parient sur le fait que l’apaisement viendra dès lors que le symptôme aura disparu. Pour le coup, ils répondent à la demande du patient de se débarrasser de quelque chose d’étranger et surfent sur l’ère ambiante de notre modernité où l’être court contre la montre, se bat avec le temps, est tendu vers un jouir toujours plus bref et plus intense que lui fait miroiter une promesse de complétude continuelle de notre société, voire de la médecine elle-même. J’ai d’ailleurs appris, il y a peu, que les neurochirurgiens sont ravis d’avoir mis au point un nouveau traitement pour se débarrasser des angoisses et des toc (troubles obsessionnels compulsifs) : la stimulation électrique cérébrale, c’est-à-dire, soyons précis, implanter des électrodes à des endroits précis du cerveau sensés être à l’origine des ses compulsions, reliées à un boitier posé sous la peau. Pas la peine de préciser que ces opérations sont remboursées par notre sécurité sociale…
Mais le sujet est où, là dedans ? Et le désir, où est-il dans ce jeu de dupes ? Dupes autant l’un que l’autre d’ailleurs, médecins et patients… mais chacun y trouve son compte, le patient rassasiant sa résistance du surmoi féroce qui jouit d’autant plus qu’il se fait mal.
Quant à ces techniciens là de la médecine, ils méconnaissent visiblement à peu près tout de ce qui s’appelle la pulsion, la libido, le désir inconscient qui pousse pour se faire entendre, quels qu’en soient les moyens. Le symptôme ne peut se liquider tant qu’il n’a pas révélé tous ses secrets !
Nous, amis de la psychanalyse, nous ne sommes a priori pas copains de nos symptômes, je dis a priori car tous les psychanalystes ne sont malheureusement pas amis du divan, certains le fuient, même, dès que possible et brandissent haut et fort le titre, le graal de « psychanalyste ». Un petit rappel pour ceux qui ne connaitraient pas le RPH, ici la cure du psychanalyste est sans fin : tant qu’il reçoit des patients, il ne quitte pas le divan. Cela n’empêche pas qu’il puisse trouver sa sortie de cure, voire même plusieurs, à savoir cet instant indéfinissable, radical, d’une rupture sans retour dans son existence où il en devient sujet, sujet adulte, responsable et désaliéné de ses symptômes, de ses résistances, de son moi. En partie, car le moi est toujours coriace et c’est pour cela même que la cure doit être sans fin, pour celui qui désire assumer cette position éthique et clinique. J’ai retrouvé une parole de Freud à ce propos :
« Quiconque prend son travail au sérieux devrait choisir cette voie qui offre plus d’un avantage. Quelque pénible que soit le fait de livrer, sans y être contraint par la maladie, toutes ses pensées à un étranger, ce sacrifice est amplement compensé [1]. »
Il ne préconisait pas de ne pas quitter le divan, comme nous le proposons au RPH, il parlait de revenir sur le divan tous les cinq ans, mais il avait tout à fait compris que les premiers à nuire à la psychanalyse sont les psychanalystes eux-mêmes, et que leur ego n’a pas intérêt à s’éloigner trop du divan.
Revenons au symptôme. Que cache-t-il de si précieux à découvrir pour l’être qui souffre ?
En 1901, Freud passe quinze jours à s’interroger sur ce qui s’est passé et sur l’échec de la cure du cas Dora, qui ne sera publié qu’en 1905, sous le titre « Fragment d’une analyse d’hystérie». C’est là qu’il mentionne pour la première fois le « bénéfice secondaire de la maladie » comme obstacle principal à la cure et à la volonté de guérir. Je ne vais pas reprendre ici les balbutiements de Freud et sa difficulté à repérer, dans le transfert, la place où il avait été mis dans cette tentative de cure psychanalytique. De cet échec ressort un concept tout à fait fondamental, le « bénéfice » de la maladie qui peut engendrer l’échec d’une cure s’il n’est pas repéré, si le clinicien, qui a pour mission de conduire la cure, ne permet pas à un moment donné au patient de reconnaître sa responsabilité dans l’affaire.
Freud écrit à ce sujet : « Celui qui veut guérir le malade se heurte, à son grand étonnement, à une forte résistance qui lui apprend que le malade n’a pas aussi formellement, aussi sérieusement qu’il en a l’air, l’intention de renoncer à sa maladie [2] ».
Ce bénéfice de la maladie, nous pouvons l’éclairer à partir de ce que Lacan a finement repéré et articulé dans sa théorie, à savoir le concept de la jouissance. Il distingue radicalement plaisir et jouissance, celle-ci résidant dans la tentative permanente d’outrepasser les limites du principe de plaisir. La quête de la jouissance renvoie à cette recherche de la chose perdue, manquante, à l’endroit de l’Autre, et cette quête est cause de souffrance. Cette souffrance fait symptôme, et ainsi, le symptôme abrite ce quelque chose en soi qui jouit d’une situation qui pourtant fait souffrir. Comment est-ce donc possible ?
Bien sur d’un point de vue théorique cela se tient et j’y viens. Juste avant cela, je souhaiterai vous faire partager une chose que j’ai entendu lors d’un séminaire qui fut pour moi tout à fait plaisant. Un psychanalyste évoquait le fait que la théorie ne pourra jamais rendre compte de l’expérience analytique, jamais. Je partage tout à fait ce constat. Cela revient un peu à la même chose que le patient qui souhaite se débarrasser de son symptôme sans en savoir davantage sur son désir, il y a là une impasse. Mais cependant, la théorie est nécessaire, sans quoi la relation clinicien-patient serait, je cite, « un délire à deux ». J’ai gardé cette formulation dans un coin de ma tête et elle continue de me parler.
La théorie est nécessaire, nous-même au RPH nous continuons à théoriser, et nous vous faisons partager nos hypothèses lors de nos colloques. Nous ne répétons pas, comme des perroquets, les paroles de Lacan ou les écrits de Freud. Je dis cela aussi parce que je le vois chez certains confrères, dans d’autres sociétés psychanalytiques. Pour ma part il n’est pas question d’appartenir à une quelconque chapelle, qui suppose d’avoir des œillères et ne correspond en rien à une démarche scientifique. Ce que nous faisons au RPH, et grâce à Fernando de Amorim, c’est une recherche scientifique à partir, bien sûr, de ce qu’ont déjà vu, entendu, constaté et théorisé nos ainés, et en ce sens, en termes d’enseignement, Freud et Lacan sont nos maitres. Mais nous en faisons une lecture critique. Nous continuons à théoriser à partir de cette théorie préexistante, essentielle, mais aussi et surtout à partir des paroles des patients et psychanalysants qui nous font l’honneur de nous rendre visite. Et c’est aussi pour cela que nous avons à cœur de défendre la psychanalyse dans nos colloques avec l’appui de ces paroles là.
Et d’ailleurs, voici une phrase d’un patient qui vient me rendre visite et qui vaut bien mieux que de longues explications théoriques sur la jouissance. Il me dit, écoutez bien cela parce que moi-même, ça m’a littéralement scotché : « Je veux bien me débarrasser de ma souffrance, mais je ne veux pas me débarrasser de ce qui me fait souffrir ». J’ai à peine eu le temps de saisir la subtilité de ces paroles que la suite m’y a aidé un peu plus : « je sais que je ne vais pas dans la bonne voie, mais je ne veux pas lâcher cette idée que changer mon apparence me rendra heureux ».
Tout est dit, il ne veut pas lâcher. Pourquoi ? Parce qu’il y a jouissance. Jouissance de quoi ? Des différentes résistances indiquées par Freud, au nombre de cinq : trois viennent du moi (refoulement, résistance de transfert et bénéfice secondaire) une du ça et une autre du surmoi, la plus féroce et qui correspond au besoin de punition. Ce qu’il ne veut pas lâcher, à savoir l’idée que changer son apparence lui fera accéder au bonheur, fait partie de son symptôme, qui est à l’intersection de ces différentes sources de jouissance que sont les résistances psychiques. Symptôme dont la médecine et la chirurgie elles-mêmes sont tout à fait complaisantes puisqu’il faut savoir que ce patient, comme beaucoup, a succombé aux promesses de la chirurgie esthétique, qui porte bien son nom. C’est de la chirurgie, donc on perce, on troue, on enfonce, on pénètre, on découpe, mais esthétique, c’est-à-dire que cela n’a rien à voir avec un quelconque problème organique à résoudre. C’est juste du fait du bon vouloir du patient, aliéné par son fantasme, sa haine, son autodestruction guidée par la résistance du surmoi, et qui dit « je veux, et j’exige, puisque je paie le prix ». Il le paie en « livre de chair », pour citer Lacan. Et c’est bien trop cher payé !
Je ne peux m’empêcher de faire le lien ici avec ce qui se passe dans notre consultation, qui est tout à fait au strict opposé de ce genre d’arrangements où chacun prend son pied. Dans sa cure le patient paie, à chaque séance, mais jamais sa demande n’est satisfaite, surtout pas. Puisque toute demande comblée étouffe le désir, et ainsi le cycle de la demande, et de l’insatisfaction, continue en roue libre sans jamais s’arrêter, si ce n’est parfois par le pire, je pense là au suicide. Tant que le désir ne s’arrime pas sur la castration, tant que les résistances du moi et du surmoi ne sont pas traversées par elle, l’être en paie le prix. Le désir est complètement englouti sous les exigences de la résistance du surmoi, de cette jouissance qui déborde, sous le poids de la demande qui renvoie au positionnement infantile à partir duquel la frustration est difficilement supportable et la castration encore moins.
Je reviens sur cette phrase : « je veux me débarrasser de ma souffrance, mais je ne veux pas me débarrasser de ce qui me fait souffrir ». Elle suffit à elle-seule à valider la pensée de Freud concernant le bénéfice secondaire de la maladie. Petit rappel sur ce que nous a enseigné Freud, la maladie procure au malade deux sortes de bénéfices :
- le bénéfice primaire qui consiste en la réduction des tensions (angoisse, conflit) par le biais du symptôme. C’est la « fuite dans la maladie ». En ce sens, il n’est pas question d’arracher au patient son symptôme, il lui permet de se protéger de quelque chose de plus insupportable. C’est pour cela qu’il faut y aller doucement, grâce au transfert, au désir, et que cela ne se résout pas en quelques séances, il est vrai.
- le bénéfice secondaire qui renvoie à l’effort que fait le moi pour pactiser avec le symptôme déjà installé. Cependant, cet effort se heurte à l’un des aspects irréductibles du symptôme qui est d’être un substitut de la motion pulsionnelle refoulée qui renouvelle, continuellement, son exigence de satisfaction et entraine le moi dans une nouvelle lutte défensive. Ces bénéfices secondaires agissent comme des satisfactions substitutives qui inhibent les fonctions du moi. Le moi n’est pas incité à lâcher ses défenses à l’origine du compromis névrotique, car les bénéfices secondaires agissent comme une confirmation du caractère adapté de la solution névrotique. Ils confortent le symptôme, en apportant une prime de plaisir, et même une satisfaction narcissique, qui contribue à la fixation de l’énergie libidinale, empêchant ainsi le moi de déplacer les investissements en vue de buts nouveaux.
Dans ces conditions, on peut difficilement envisager une levée des symptômes sans un changement radical du fonctionnement du moi. Les symptômes sont en effet attachés à la position psychique, elle-même embastillée par l’ignorance et la haine de l’être quant à son désir inconscient qui agit à son insu, puisqu’il n’en veut rien savoir, pour le moment. Ainsi, les symptômes ne peuvent disparaître que par un changement de position psychique qui les rend tout simplement caducs, inutiles grâce à un changement radical de la circulation libidinale dans l’appareil psychique.
Pour cela, il aura à déchiffrer, dans sa cure, son symptôme, déchiffrer ce qui est chiffré, codé, rendu secret : à savoir la jouissance qu’il tire des différentes résistances psychiques qui l’assaillent, et autrement dit, reconnaître sa responsabilité dans l’affaire. Ce que Freud a très vite repéré, à savoir rendre manifeste le contenu latent, faire advenir à la conscience le refoulé, Lacan l’a reformulé en terme de révéler et réveiller le désir, par la castration de cette jouissance, qui n’a pas d’autre possibilité d’apaisement que cette castration symbolique. Celle-ci advient au fur et à mesure de la cure, à partir du moment où l’être va piocher dans le grand Autre, à partir du moment où il accepte, grâce au transfert, de venir dire ce qui lui traverse l’esprit.
Et d’ailleurs, cette phrase du patient, aussi claire soit-elle sur la force de ses résistances, il est quand même venu la dire face à quelqu’un, il a même payé pour cela, il se l’entend dire, et à partir de là, un changement peut s’amorcer, s’il s’accroche à son désir évidemment. Les échecs des cures sont ainsi souvent dûs au fait que le patient ne souhaite pas céder sur cette jouissance et qu’il ne veut rien perdre des bénéfices de son symptôme, souvent orienté vers un Autre d’ailleurs. C’est cela le métier du psychanalyste, demander encore et toujours au patient d’associer librement ses pensées afin que puisse advenir l’inattendu, l’insupportable, le gênant, le troublant et que petit à petit, séances après séances, il passe d’une jouissance morbide et mortifère et à une sage jouissance, où il n’y a pas d’autre prix à payer que celui de la castration. Lacan a eu cette magnifique formule :
« La jouissance, c’est le tonneau des Danaïdes, une fois qu’on y entre, on ne sait pas jusqu’où ça va. Ça commence à la chatouille et ça finit par la flambée à l’essence [3] ».
Ainsi, le malade, le patient ou le psychanalysant, qui présente un état morbide a priori non voulu, subi, pense n’être pour rien dans ce qui lui arrive. Ce refus de s’interroger sur son histoire, sur son désir, lui permet de répéter, de subir en continu la ritournelle de la jouissance, de ses résistances, qu’elles viennent du ça, du moi ou du surmoi. Pourtant, ce que nous apprend la psychanalyse, c’est que être souffrant est, au moins pour une part, l’œuvre d’une intention, que c’est dans une certaine mesure voulu.
C’est cette jouissance là, qui pousse à la contrainte de répétition, qui met en échec les autres praticiens, médecins, psychiatres et psychothérapeutes, malgré les médicaments et technique de reconditionnement psychique, puisqu’ils ne prennent en compte ni l’inconscient, ni les résistances psychiques, ni la jouissance qu’elles suscitent et la nécessité de leur castration. De ce fait, à partir du moment où la vie du sujet s'indexe non plus sur le désir, qui doit s'accommoder peu ou prou de la castration, mais sur la jouissance, la vie devient insupportable et la survie de celui qui en souffre, et qui désire véritablement autre chose pour son existence, dépendra du courage qu’il aura à venir associer ses pensées pour découvrir en quoi il y est pour quelque chose dans cette affaire qui l’empêche de vivre sa vie convenablement. Et il peut compter, pour cela, avec le désir du psychanalyste !
Julie Vu Tong
[1] Freud S. (1912) « Conseils aux médecins », in La technique psychanalytique, Paris : PUF, 1970, p. 67.
[2]Freud S. (1905) « Fragment d’une analyse d’hystérie », in Œuvres Complètes, vol VI, Paris : PUF, 2009, p. 223.
[3] Lacan J. Le Séminaire, Livre XVII, L’Envers de la psychanalyse, Paris : Seuil, 1991, p. 83.